En quoi la notion de jardin a-t-elle guidé cette exposition ?
Nelson Pernisco – Avec mon collectif le Wonder, on a vécu dans une ancienne usine à Saint-Ouen où la nature avait repris le dessus. C'était très agréable d'avoir en ville cet espace vert. Puis il y a deux ans, on a déménagé à Bagnolet et on s’est retrouvés avec un parking extérieur, adjacent au périphérique. En plus, on arrivait en plein hiver, c’était assez dur. Mais on s'est mis à dépasser ça par le langage : le périph, dans ce flux continu, était comme une rivière, le parking est devenu jardin et le rooftop, balcon. Dans ce parking-jardin, on a commencé à exposer nos sculptures, qui sont assez volumineuses. Elles pouvaient y prendre l'air du temps, évoluer avec l'érosion de la pluie, de la neige et du vent. Ça a beaucoup influencé mes réflexions dans mon travail personnel.

J'ai nourri une pratique qui se rapproche du jardin. Tous les matins maintenant, quand je me lève, c'est toute une organisation : il faut que je nourrisse une sculpture, que j’arrose une deuxième, que je remette un peu d'acide dans la troisième.
L'exposition devient du coup un extrait de cette pratique de jardin d'atelier.
Comment avez-vous élaboré vos œuvres ?
J'ai construit l'exposition à partir de thèmes qui m'habitent en ce moment, à savoir le temps et, par extension, le vivant. Je l'emploie ici comme un matériau, une façon de m'affranchir des limites de l'espace de l'exposition. Dans une galerie ou un musée, il y a toujours un certain enfermement. Le temps me permet de m'en échapper, ou au moins de sortir le visiteur de sa position de consommateur.

La première pièce est un moteur de voiture qui se transforme en caillou. Une sorte de fontaine d’acide vient le ronger de l’intérieur et de l’extérieur, comme pour le libérer de sa forme industrielle afin qu’il reprenne un jour une forme plus minérale. Il se voudrait d'un temps immuable, qui nous dépasse.

Puis on arrive à la sculpture avec les rats. Ils ont réadapté leur mode de vie au milieu de pièces de bagnoles détachées, dans cette cage qui paraît sur le point de se muer en hélicoptère-bateau. Même si ça reste très violent : l'humain les capture, il se rend maître et possesseur. Les rats n'ont finalement pas beaucoup de chances de s’en sortir. Il y a une notion d'anthropocène, l'homme intervient sur son environnement.

Après, on trouve une structure autosuffisante : un bac d'eau se déverse goutte à goutte dans un bac de terre, avec des lampes à sodium qui permettent à des courges de se développer. Tout un écosystème hors-saison en intérieur, qui les laisse faire leur vie sur cette architecture industrielle. On est là encore dans une sorte de frustration :
Les courges vont-elles être laissées à la pourriture ? Va-t-on les manger ? Comment cela a-t-il démarré ? Est-ce qu'elles auraient pu pousser autrement ?
Ça donne, si ce n'est l'envie de revenir, au moins celle de s'informer ou de s'interroger sur la représentation de cette pièce. Parce qu’elle existe dans plusieurs états à la fois. Je n'interviens plus trop, ça me permet aussi de me remettre en question en tant que spectateur.
Il y avait un aspect politique plus explicite dans vos œuvres précédentes, qui semble adouci. Aujourd’hui, c'est en plantant des graines qu'on hacke le système ?
Je ne pense pas que ce soit moins politique, c'est moins réactionnaire. Oui, faire intervenir du vivant, dans la période qu'on est en train de vivre, c'est extrêmement politique. Mon travail continue de tourner autour de la catastrophe, je m'intéresse beaucoup à la collapsologie. Mais c'est la première fois que j'arrive à être force de proposition avec mon travail, là où avant c'était surtout de la description dystopique. Avec le Wonder, on a développé toute une pratique de la fin du monde : sans vouloir en faire un truc sexy ni cultiver un survivalisme hollywoodien, mais dans notre manière de vivre comme des minorités dans ce quartier, il y a des parallèles qui se font avec l'idée de se reconstruire dans un monde qui serait partiellement effondré.
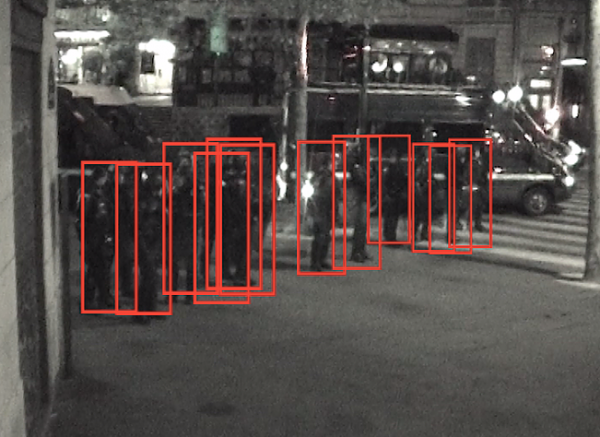
L'artiste, à mon sens, n'est pas là pour donner des solutions ni des leçons, mais exprimer des étapes de recherche. Par exemple, le mouvement des gilets jaunes m'interroge, même si je les soutiens :
Pourquoi manifester pour le pouvoir d'achat, alors que l'argent ne représentera plus rien dans quelque temps, par rapport à ceux qui sauront travailler la terre ?
Ces sculptures étaient aussi une forme d’apprentissage : c'est un peu candide à dire mais c'était la première fois que je plantais une graine. Moi j'ai grandi à Paris, j'ai eu plusieurs plantes mais à partir de boutures. Là, je suis parti de zéro. C'est une ouverture d'esprit énorme, que de faire pousser un arbre.
Vous reconnaissez-vous dans le courant d'un "art écologique" ?
Mon point de vue évolue là-dessus. Je trouve qu'il y a un effet de mode, un truc vendeur à saisir dans l'art. En même temps, de plus en plus, j'ai l'impression qu'on ne peut plus faire autrement, ce ne sont pas juste des lubies : tout en revient forcément à l'écologie. Parce que le monde est clairement en train de se transformer.
Ce serait même compliqué aujourd'hui de produire une œuvre sans aborder ce sujet.

Ça a commencé à émerger dans mon travail quand j'ai compris que c'était une catastrophe, qui arrive non pas d’un coup, mais doucement, sur le long terme. L'idée de la destruction sous toutes ses formes est très présente chez moi, j'ai beaucoup bossé sur l'iconoclasme, sur la cohabitation du chantier et de la ruine dans les villes. Je suis quand même bien plus attiré par tout ce qui est de l'ordre du rebut, du démoli, de l'abject, du déchet, que par ce qui est fini, trop lisse. Aujourd'hui, je fais pousser des courges, ça a forcément un lien. La structure fait intervenir les cinq éléments qu'on retrouve dans les dictionnaires chinois, à savoir l'eau, le métal, le bois, la terre et le feu – en considérant que la lumière représente le feu et que les plantes font office de bois. C’est une installation assez complète, à but non-scientifique, qui me permet de mettre en exercice le monde dans lequel je vis, d'essayer de le comprendre par des procédés un peu absurdes.
Désormais, j’ai aussi une sorte de responsabilité vis-à-vis de mes pièces. Je ne peux plus les mettre dans une caisse au sous-sol et les oublier : les rats il faut les nourrir, les courges je n’ai pas envie de les arracher à la fin de l'expo. Donc je continue.
Sur quoi travaillez-vous maintenant ?
Ce n’est pas évident de vous répondre parce que nous sommes en plein déménagement. Mais je regarde du côté de l'autotrophie : c’est la façon qu’ont les plantes, par exemple, de se nourrir sans avoir besoin de se déplacer, essentiellement à partir de ce qui vient à elles, la lumière, les minéraux. Je commence à me demander s’il ne faudrait pas qu'on devienne tous autotrophes rapidement si on veut survivre !
Si par parking vous comprenez jardin
+ Papapapapaaa papa paam
31 janvier au 2 mars 2019
Galerie Bertrand Grimont
42-44 rue de Montmorency 75003 Paris
Pour plus d'informations, cliquez ici.
Nelson Pernisco – Wonder/Liebert
Retrouvez toutes nos propositions de sorties culturelles (et durables) dans notre agenda participatif.





 À Marseille, le rap au service de l’environnement
À Marseille, le rap au service de l’environnement
