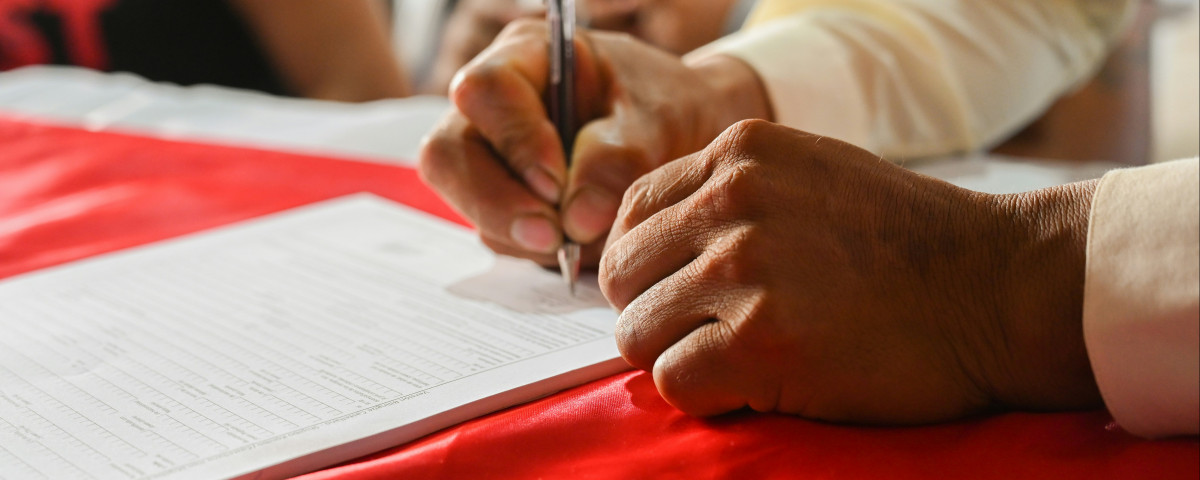C’est une situation inédite dans l’histoire de la Ve République. Dimanche 20 juillet 2025, la pétition "Non à la loi Duplomb" a dépassé le seuil du million de signatures et ce chiffre ne fait que croître jour après jour. Concrètement, que peut-il se passer maintenant ?
La constitutionnaliste Anne-Charlène Bezzina prédit, dans un entretien à l'AFP, "un véritable casse-tête chinois" où les groupes parlementaires, le président de la République, le Conseil constitutionnel et le juge administratif auront leur rôle à jouer.
"La possibilité des pétitions en ligne date de 2019 et marque le signe d'une ouverture souhaitée de l'Assemblée aux débats citoyens, rappelle la constitutionnaliste. On est ici dans un exemple très concret de démocratie participative qui pourrait faire bouger des lignes."
Âgée de 23 ans, la jeune femme à l’origine de la pétition se présente comme étudiante et "future professionnelle de la santé environnementale et de la responsabilité collective". Elle dénonce ce qu’elle juge être "une aberration scientifique, éthique, environnementale et sanitaire".
Une loi non-applicable ?
La pétition a été ouverte il y a 10 jours, en réaction à l’adoption de la loi Duplomb, du nom du sénateur Les Républicains (LR) à l’origine de cette proposition. Le texte prévoit la réintroduction de l’acétamipride, un insecticide réclamé notamment par les producteurs de betteraves et de noisettes. Ces derniers se plaignent d’une "concurrence déloyale" avec le reste de l’Union européenne, là où ce produit est autorisé.
Il est toutefois reconnu comme dangereux pour les abeilles et la biodiversité. Les risques sur la santé humaine ne sont cependant pas avérés, faute d'études d'ampleur.
"La réintroduction de l'acétamipride supposera des décrets d'application. La loi prévoit simplement une clause de revoyure à l'issue d'une période de trois ans, pour s'assurer que les conditions d'utilisation sont toujours remplies. On voit bien que le législateur marche sur des œufs", constate Anne-Charlène Bezzina.
"Les décrets d'application vont certainement faire l'objet de recours devant la justice administrative. Elle peut se prononcer sur le principe de précaution ou décider qu'il y a une inégalité de traitement entre les agriculteurs, par exemple, entre ceux qui ont le droit d'utiliser le pesticide et ceux qui n'ont pas le droit. Tant que les décrets sont attaqués en justice, la loi n'est pas applicable", soutient-elle.
Au moins 30 départements représentés
À travers cette initiative, fortement relayée sur les réseaux sociaux, la pétitionnaire demande l'“abrogation immédiate” de la loi, "la révision démocratique des conditions dans lesquelles elle a été adoptée" et "la consultation citoyenne des acteurs de la santé, de l'agriculture, de l'écologie et du droit".
Si la pétition dépassait les 100 000 signatures, cela lui garantissait d’être publiée sur le site de l’Assemblée nationale et d’être discutée en commission des Affaires économiques. Maintenant qu’elle a dépassé le seuil des 500 000 signatures, "la Conférence des présidents de l'Assemblée nationale peut donc facilement, comme le prévoit son règlement, décider d'organiser un débat dans l’hémicycle", précise Anne-Charlène Bezzina. Une première dans l’histoire politique française.
"Cela ne signifie pas que la loi sera réexaminée sur le fond, mais ce sera une première sous la Ve République et, vu la mobilisation citoyenne, il [le débat] sera particulièrement scruté", affirme Anne-Charlène Bezzina.
Dans les faits, l’Assemblée va d’abord se charger de vérifier la validité de toutes les signatures pour éviter les tentatives de fraudes. Chaque signataire doit avoir indiqué son nom, son prénom, son adresse électronique et postale. Pour permettre à la pétition de poursuivre son chemin législatif, ils doivent venir d’au moins 30 départements français.
Le Conseil constitutionnel saisi
Le 11 juillet dernier, le Conseil constitutionnel a été saisi par des députés de gauche qui y ont déposé un recours pour tenter de censurer la loi. Le Conseil a un mois pour se prononcer.
"Ils espèrent une censure, notamment, car la loi Duplomb a fait l'objet d'une motion de rejet préalable, ce qui a empêché tout réel débat dans l’hémicycle", explique Anne-Charlène Bezzina.
"Il est très peu probable que les Sages censurent pour vice de procédure : ils ont déjà jugé dans le passé que les motions de rejet, jugées ‘détournées’ de leur esprit par les oppositions, n'étaient pas de leur ressort", ajoute-t-elle.
Dans leur recours, les députés de gauche estiment aussi que la réintroduction de l'acétamipride contrevient à deux principes constitutionnels : le principe de précaution, qui oblige à prévenir des dommages environnementaux graves même en cas d'incertitude scientifique, et le principe de non-régression, qui interdit de revenir en arrière sur les avancées en matière de protection de l'environnement.
À lire aussi : Qu’est-ce que l’éco-anxiété ?
Mais ils sont très généraux et leurs implications concrètes sont susceptibles d'interprétation par le législateur.
Il semble donc peu probable que la loi dans son ensemble soit censurée. En revanche, il y aura sans doute des réserves d'interprétation : les Sages vont demander des gages sur certains points précis."
Retarder la promulgation ?
Pour rappel, si le Conseil constitutionnel valide la loi Duplomb, elle doit encore être promulguée par le président de la République. "Mais il peut retarder cette promulgation et demander une seconde délibération au Parlement. Le chef de l’État, en tant que garant de la cohésion nationale, pourrait choisir cette option vu qu'en l'espèce un nombre important de citoyens s'opposent à ce qui a été voté au Parlement", conclut Anne-Charlène Bezzina.
Avec AFP.